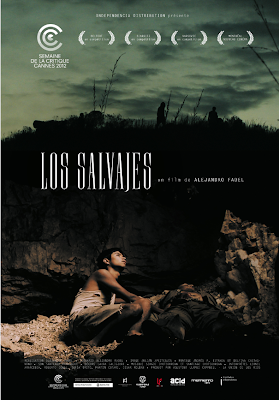Réalisé par Wong Kar-wai; écrit par Xu Haofen, Jingzhi Zou et Wong Kar-Wai
... Le mouvement des êtres
Nous n’avions pas revu Wong
Kar-wai depuis My blueberry nights en
2007 et ses errances romantiques et mélancoliques en Amérique. La surprise
était donc légitime lorsque l’on a su qu’il allait mettre en scène un film
autour de la vie de Ip Man (interprété par Tony Leung, son acteur fétiche), un
célèbre maître chinois d’art martial, futur mentor de Bruce Lee. Qu’est-ce que
le Kung-fu venait faire dans la filmographie du fameux réalisateur de In the mood for love (2000)? Or, les connaisseurs se souviennent que son troisième film s’essayait déjà à
un autre genre bien particulier, celui du Wu Xia Pian (film de sabre) à travers
Les Cendres du temps (1994), à la
réception difficile et dont il proposa d’ailleurs une version remontée (Cannes
2008). Il n’est donc pas novice dans l’art de mettre en scène des combats aux
ressorts spécifiques. Ainsi, il est d’emblée intéressant de voir comment un
cinéaste, que la majorité des spectateurs ne connaisse pas dans ce registre, va
s’approprier un autre univers. Car Wong Kar-wai n’a pas subitement changé de
style, il s’agit bien sûr moins d’un film de kung-fu qu’une réflexion sur le kung-fu. Et donc d’une
philosophie de vie, qui, si elle va bien s’illustrer par le combat, va être
dominée par une histoire d’amour, inévitablement teintée de tristesse.
La majestueuse séquence
d’ouverture (affrontement sous la pluie de
Ip man contre une multitude d’assaillants) offre d’ailleurs une quintessence
visuelle qui éblouit. Comme si le réalisateur nous montrait immédiatement qu’il
sait aussi filmer un combat tout droit sorti de Matrix Revolutions (scène similaire de Néo se battant contre
l’agent Smith démultiplié sous une pluie diluvienne). Et que son art peut tout
autant s’y illustrer. Focalisation sur des détails (le chapeau, les gouttes d’eau
sur le sol, le pied) souvent filmés au ralenti, au milieu des coups et des
attaques. Wong Kar-wai abandonne ici la tentation de l’abstraction vers
laquelle tendaient les combats des Cendres
du temps. Car la démarche est de mettre en valeur la beauté de ce qu’on
appelle à raison art martial. Le
travail d’orfèvre de la réalisation fait écho à celui des prises qui ne sont
pas juste des coups mais des actions nominatives qu’il faut savoir agencer et
distribuer. Une première séquence forte donc pour mieux être diluée par la
suite. A la différence du diptyque consacré à la vie du maître (Ip Man 1 et 2, Wilson Yip) qui mettait
en exergue de nombreux combats, Wong Kar-wai privilégie évidemment ce qui ne
l’est habituellement pas dans les films du genre, à savoir le lyrisme, à
travers les deux experts en combat que sont Ip Man et Gong Er (Zhang Ziyi,
qu’il avait déjà fait tournée dans 2046).
Wong Kar-wai évite de se servir
du kung-fu comme simple toile de fond, les destins des personnages sont
étroitement liés à leur pratique et aux préceptes même de leur art. Car chacun
des deux en maitrise un différent, lui le Wing
Chun, elle le Ba Gua. « Nous nous découvrons à travers
l’échange avec l’autre » professait sagement Huo à propos de l’art
martial dans Le maître d’arme (Ronny
Yu, 2006). Et en effet, la rencontre entre Ip Man et Gong Er est un moment de
bravoure, et, alors même qu’il s’agit d’une démonstration de combat, on y
retrouve ces regards, ces hésitations, ces frôlements de peau si caractéristique
au réalisateur. Ballet martial et amoureux dans un même élan. On passe ainsi,
parfois de façon abrupte, comme cela était le cas dans son As tear goes by en 1988 (où amour et bagarre s’entrechoquaient déjà
et où la violence surgissait comme un coup soudain), d’un tableau typique de
Wong Kar-wai (la scène du buffet au ralenti sur un air d’opéra) au combat
précité. L’amour est encore plus esquissé que lors de ses films précédents, à
peine le mouvement d’un effleurement et les destins se vivront différemment. Car
il y a Ip Man, qui avance et vit (ce qui sera souligné par la citation finale
de Bruce Lee) tandis que Gong Er se choisit un but : le sacrifice pour
honorer son héritage, celui de l’art que lui a transmis son père.
C’est ce personnage féminin qui
est certainement le plus tortueux, l’accomplissement de son désir (défier
le disciple qui a trahi son père) étant lié au renoncement. Son combat floconneux
est d’une grâce subtile, la poésie côtoie la tension dramatique sur un quai de
gare où au ras d’un train qui passe au ralenti se joue et se déjoue l’existence.
Le train continue sur sa voie, comme Ip Man, qui traverse ses saisons de vie
(récurrence des photographies sépia) tandis que Gong Er cède à l’aiguillage
d’une voie sans issue. Le choix du kung-fu permet ainsi à Wong Kar-wai de
donner une ampleur nouvelle à ses thématiques, la virtuosité chorégraphique des
corps donnant la réplique aux épanchements d’âmes cinématographiques.
17/04/13
Sélectionné et publié par le Plus du nouvelobs.com